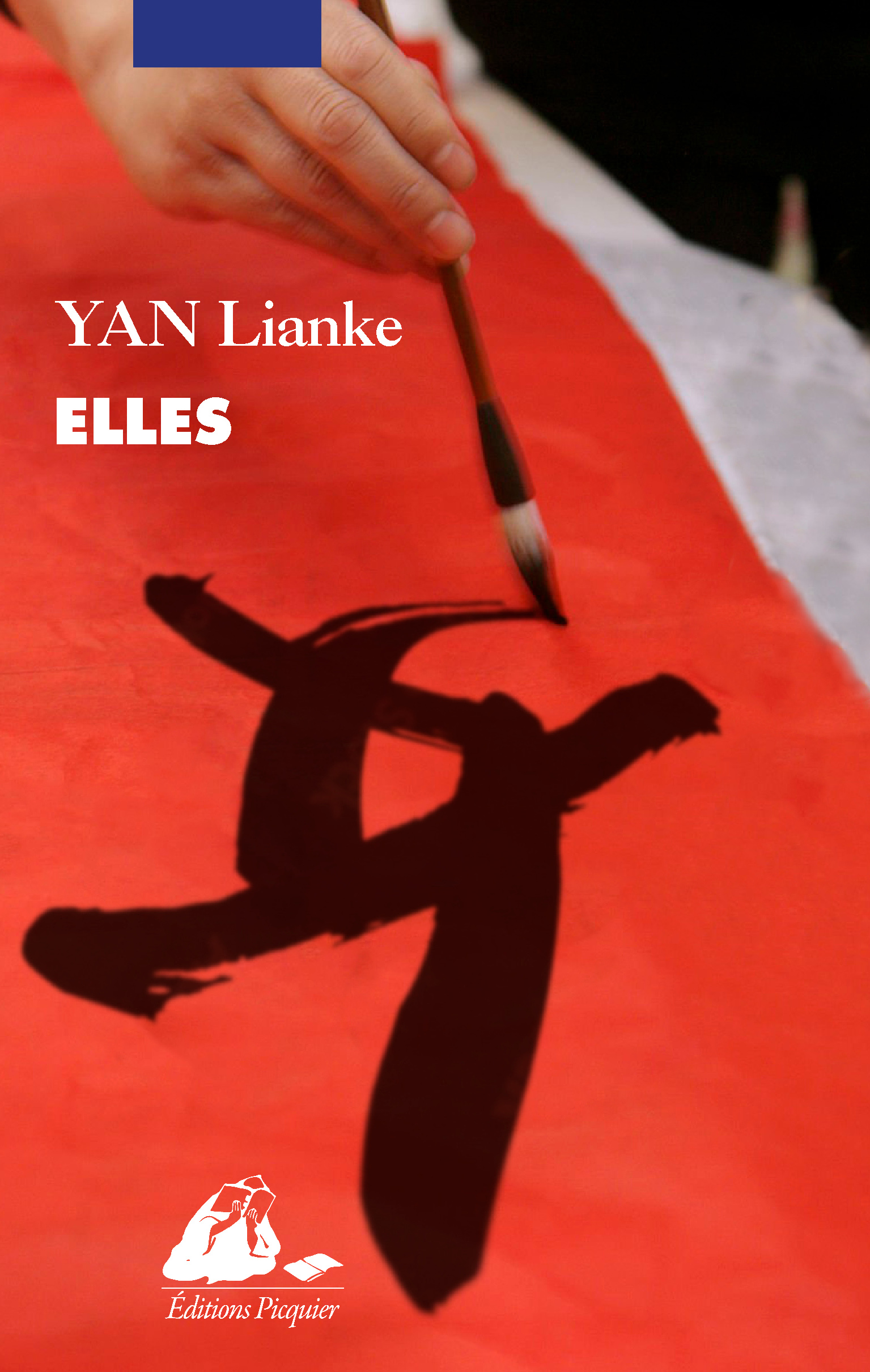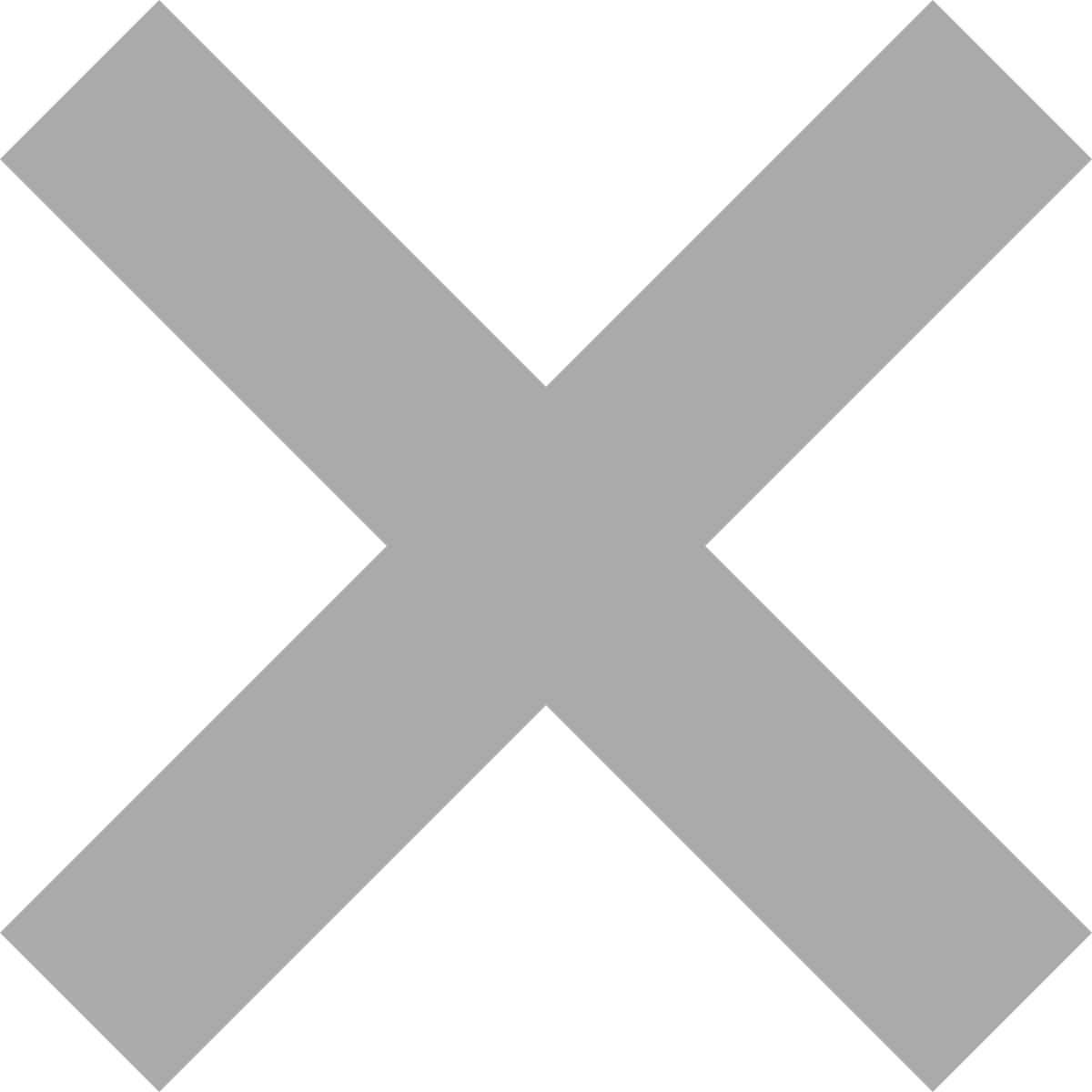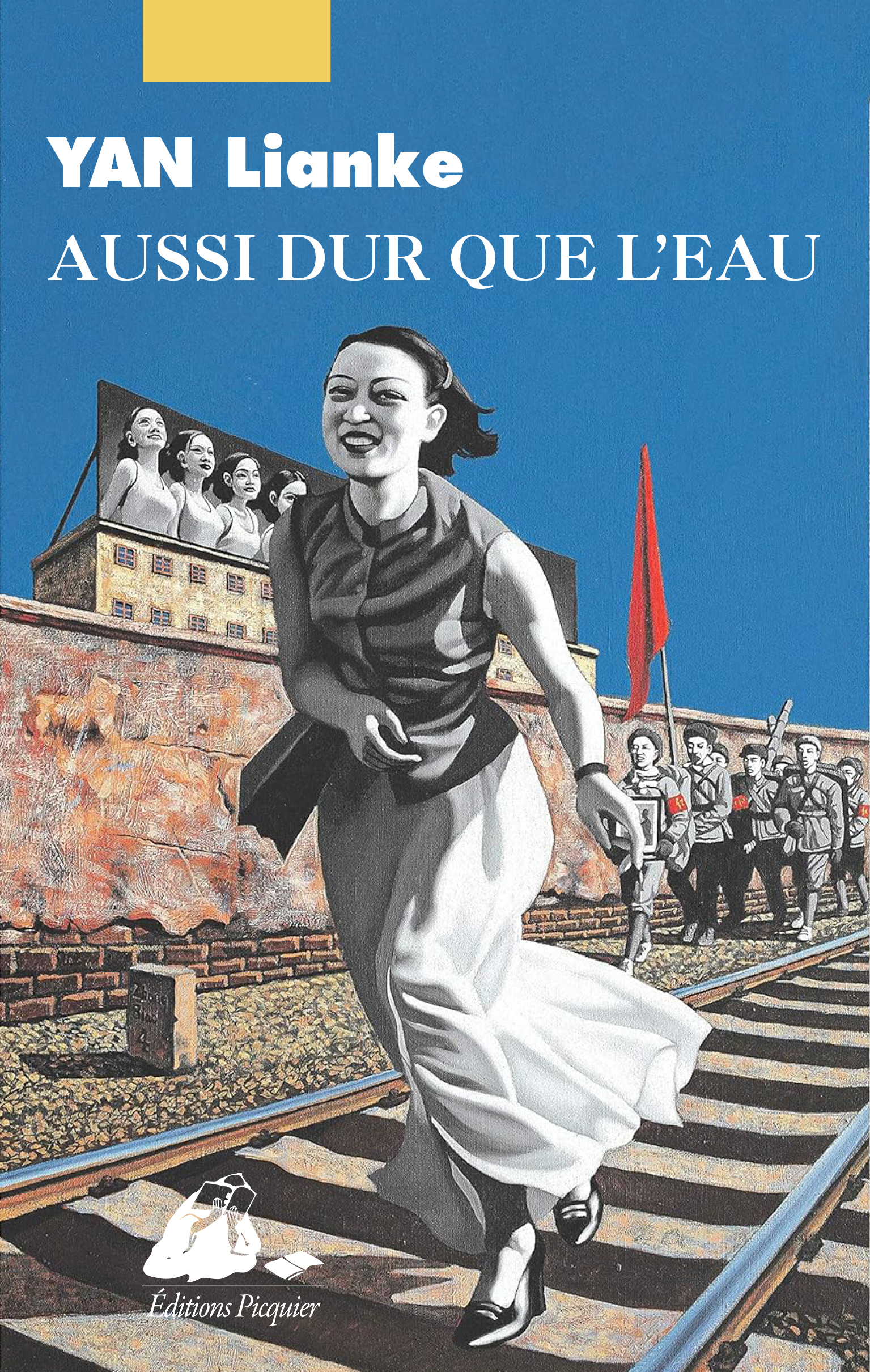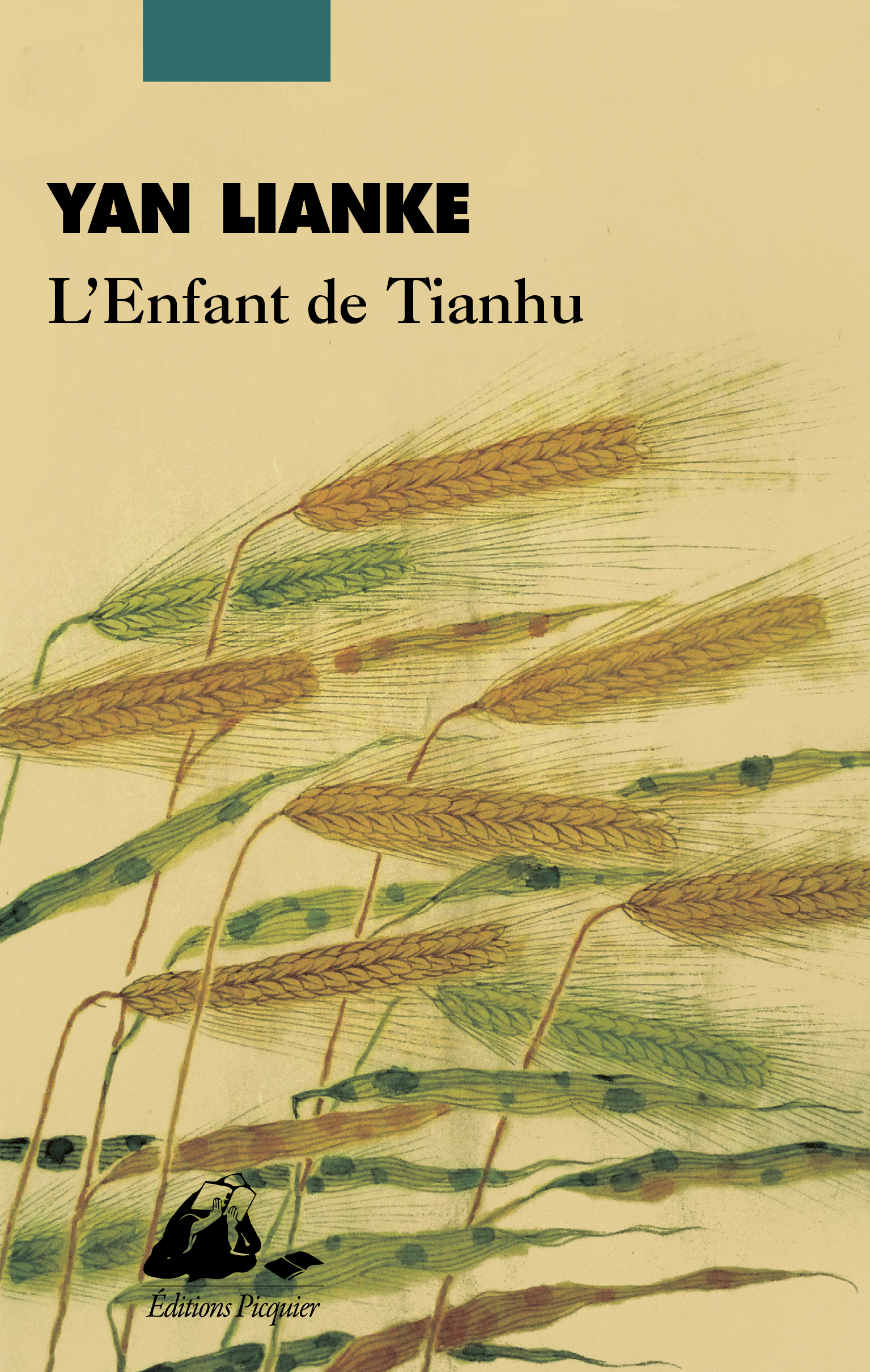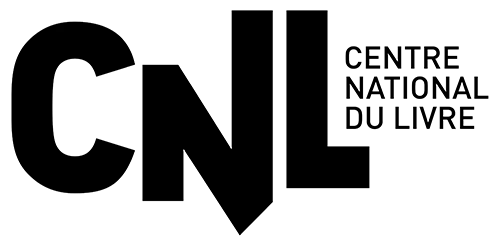septembre 2022
978-2-8097-1600-9
21,50 €
272 pages
Après avoir attendu pendant dix ans, j’ai senti un jour que je pouvais écrire Elles.
J’ai écrit leurs larmes, leurs rires, leurs silences et leurs fureurs. J’ai écrit leurs souffrances tues et leurs prises de conscience.
Pour l’écrire, j’ai employé toutes mes forces, ma sincérité, mon amour et ma compréhension des êtres, tout le respect et l’estime que je porte à ces femmes nées êtres humains.
C’est à sa mère, à ses sœurs, à ses tantes et aux femmes de son village que Yan Lianke pense en écrivant. Des femmes résistantes qui conjurent la misère en chantant, dont les magnifiques portraits se tissent de souvenirs d’enfance et d’analyses sur l’amour, le mariage et la condition des femmes dans la Chine rurale.
Car ces femmes qui l’ont aimé et ont façonné son existence d’homme et d’écrivain, Yan Lianke est convaincu qu’elles ont été injustement oubliées, effacées de la mémoire des hommes. Ce livre profondément émouvant est né de sa volonté de leur rendre hommage et de leur donner une visibilité qu’elles n’ont jamais eue.